La première date de l’histoire officielle
de la Martinique est l’arrivée de Christophe Colomb,
en 1502, le jour de la Saint-Martin.
Appelée Madinina, « l’île aux fleurs
» ou Jouanacaera, « l’île aux iguanes
», la Martinique devient française en 1635, et est
gérée par la Compagnie des Isles d’Amérique,
créée par Richelieu.
Les fondements de la société d’habitation,
une première fois sapés par l’abolition de
l’esclavage, proclamée le 22 mai 1848 après
la révolte des esclaves de la région de Saint-Pierre,
vont être progressivement remis en cause pendant le XXème
siècle.
Celui-ci commence pour la Martinique avec le traumatisme de l’éruption
de la Montagne Pelée, le 8 mai 1902, qui annihile la ville
de Saint-Pierre et 30.000 de ses habitants.
La loi du 19 mars 1946 établit la Martinique comme département
d’outre-mer.
Le 15 juin 1502 : Christophe Colomb débarque
à la Martinique, plus précisément sur le
site de l’actuelle commune du Carbet. L’île
est habitée depuis plusieurs siècles.
Les plus anciens vestiges archéologiques attestent en effet
d’un peuplement humain remontant au deuxième millénaire
avant notre ère.
Les mouvements de population dans l’espace caribéen
ont en effet peuplé et dépeuplé les îles
au gré des flux et des reflux.

Venus du bassin de l’Orénoque (actuel Venezuéla),
les Arawaks se sont installés en Martinique vers 100 avant
J-C, dans le cadre d’un vaste mouvement qui a concerné
l’ensemble des îles de la Caraïbe, jusqu’aux
Grandes Antilles.
Vers le Xème siècle, l’arrivée
des Caraïbes provoque un bouleversement dans l’ensemble
de la Caraïbe, au rythme de leur conquête progressive
des îles de l’arc antillais.
Leur arrivée en Martinique est datée vers 1350,
ce qui explique que les premiers Européens aient pu trouver
chez les populations indigènes des traits des cultures
Arawaks (notamment chez les femmes, épargnées lors
des combats et qui continuaient à parler leur propre langue,
distincte de celle des hommes).
1630 : Faible éruption de la montagne
Pelée.
La cohabitation entre les Français, arrivés en
1635, et les Caraïbes fut caractérisée par
des périodes d’entente et des conflits sanglants,
qui aboutirent au départ des Caraïbes à la
fin du XVIIème siècle.
Leurs traces demeurent tant dans la toponymie (communes de Case-Pilote
et Rivière-Pilote, nommées en souvenir d’un
chef Caraïbe) que dans des noms vernaculaires de plantes
(manioc) ou d’animaux (anoli, manicou) entre autres.
De nombreux sites archéologiques précolombiens
existent en Martinique, essentiellement le long des côtes,
où étaient installés les villages.
Le principal site est celui de Vivé, entre Macouba et Basse-Pointe,
sur la côte Nord-Atlantique. La roche gravée (pétroglyphe)
de la forêt de Montravail, dans la commune de Sainte-Luce
(Sud de la Martinique) compte également au nombre de ces
traces.
En 1635 : Est créée par Richelieu
la nouvelle "Compagnie des Isles d’Amérique"
ou "Compagnie Saint-Christophe". Un contrat est passé
entre celle-ci et les Sieurs Lienard de l'Olive et Duplessis d'Ossonville,
qui s’engagent dès lors à occuper et à
gouverner pour son compte, les îles de la Caraïbe relevant
de la couronne de France.
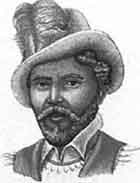
Le Normand Pierre Belain d'Esnambuc s’établit à
la Martinique le 15 Juillet 1635, avec une centaine de compagnons.
Il débarque à l’embouchure de la rivière
Roxelane, sur le site de l’actuelle commune de Saint-Pierre,
où est fondée la ville du même nom, première
capitale de l’île.
Le premier statut institutionnel de la Martinique est alors celui
d’une terre française administrée et exploitée
par une compagnie à vocation commerciale.
Le 20 septembre 1650 : La Compagnie des Isles d’Amérique
fait faillite et les îles sont à vendre. Jacques
Dyel du Parquet, neveu de Belain d'Esnambuc, achète la
Martinique.
Il vécu en bonne entente avec les indiens Caraïbes.
On lui doit la constitution de Fort Royal, actuellement Fort-de-France,
et l'introduction de la canne à sucre.
Mais à sa mort en 1658, la cohabitation avec les Caraïbes
dégénéra en guerre ; et ces derniers furent
massacré ou chassés dans d'autres îles en
1660.
Le développement de la culture de l’indigo, du café
puis, au fur et à mesure de la conquête de terres
arables aux dépens des Caraïbes, de la canne à
sucre, s’accompagne de la mise en place d’un système
économique basé sur l’esclavage.

La traite transatlantique amène en Martinique et dans
toute la Caraïbe des centaines de milliers de captifs originaires
pour l’essentiel d’Afrique occidentale.
1664 : Jean-Baptiste Colbert dirige la
fondation de la Compagnie des Indes occidentales. Les îles,
dont la Martinique, reviennent par conséquent, à
la couronne de France.
Dès 1674 : Le Roi retrouve ses prérogatives
et met en place un gouvernement militaire unique pour les colonies
de la Caraïbe, qui réside en Martinique.
16 juillet 1674 : La flotte de l'amiral
hollandais Ruyter se présente devant Fort Royal, défendu
par le chevalier de Sainte-Marthe. La ville reste aux mains des
Français.
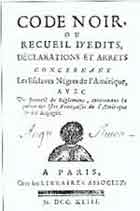
En 1685 : le
Code Noir, est promulgué à l’initiative
de Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, est destiné
à réglementer l’esclavage dans la colonie
en donnant un statut spécial et légal au système
sur lequel repose l‘économie de la colonie.
Les esclaves sont définis comme des biens mobiliers, certains
sévices sont interdits tandis que d’autres sont institutionnalisés.
Sur le plan des institutions locales, l’administration des
colonies est marquée par la suprématie de l’autorité
militaire, qui, en raison de l’éloignement de la
France, concentre en son sein l’ensemble des pouvoirs.

1694 : Arrivée du père
Labat, missionnaire dominicain, ethnologue, explorateur, écrivain,
agriculteur. A son arrivée en Martinique, il est affecté
à la paroisse de Macouba, Il fonde l'habitation Saint-Jacques,
une plantation de canne à sucre en 1696. L'habitation Fond
Saint Jacques est située en bordure de la rivière
du même nom, dans la circonscription du nord atlantique.
L'habitation fut longtemps considérée comme un modèle
sinon comme une référence, ce qui se trouve encore
aujourd'hui dans le vocabulaire, tel que "La Tour du père
Labat" (un moulin à vent), "les chaudières
Père Labat" ou encore l'appareil de distillation "type
Père Labat". Il fonde la paroisse du François
ou il développe l'industrie sucrière.
Le père Labat témoigne à travers ses écrits
"Voyages aux îles d'Amérique" d'une époque
avec de nombreux détails.
Le 17 Mai 1717 : Les connétables de la Martinique levèrent l'étendard de la rébéllion. Ils firent arrêter de la Varenne, le Gouverneur-Général et de Ricouard, l'intendant. Le 23 mai suivant, ils les firent embarquer violemment pour la France.
Le 15 Mars 1718 : Le Chevalier de Feuquière fut nommé Gouverneur-Général de la Martinique.
1762 - 1763 : Occupation anglaise de la
Martinique. En fait l'île sera attaquée par les Anglais
en 1759. Repoussés par les milices martiniquaises à
la pointe des Nègres et au morne Tartenson, ceux-ci opéraient
trois ans plus tard, en janvier 1762 un débarquement victorieux,
s'emparaient du morne Garnier d'où ils pilonnaient le fort
Royal qui devait capituler le 4 février. Cependant, après
une occupation de neuf mois, le Traité de Paris, qui nous
faisait perdre le Canada, rendait l'île à la France.
La Martinique redevenait le siège du gouvernement des îles
de vent en 1768.

1763 : Naissance de Joséphine
Tascher de la Pagerie aux Trois-Ilets, future impératrice
des Français sous Napoléon Premier.
Le 9 Août 1777 : Une déclaration du Roi renouvelle l'interdiction d'amener dans le royaume aucuns noirs, mulâtre, ou autres gens de couleurs, de l'un ou l'autre sexe, sous peine de 3000 livres d'amende, et de renvoyer aux colonies les noirs et mulâtres qui se trouvent dans le royaume.
Le 9 Février 1779 : Un réglement fit interdiction expresse aux gens de couleur libres de s'habiller comme des blancs.
Le 6 Novembre 1782 : Une ordonnance du Roi vint interdire, aux curés et officiers public de qualifier aucunes personnes de couleur libres du titre de "sieur et de dame".
Le 7 Juin 1784 : Une Assemblée Coloniale est crée dans chaque colonies des Antilles. Elle est composée du Gouverneur, de l'Intendant, du Commandant en second, du Commissaire-général de marine, de deux député du conseil souverain, d'un député de chaque quartier, des députés des Îles dépendantes, d'un député des principales villes et, d'un secrétaire nommé à vie.
Les membres devaient être renouvelés tous les quatre mois.
C'était pour les colonies, une vrai charte constitutionnelle. Malgrés, qu'elle fut corrompue, par et au profit de l'aristocratie locale.
Le 29 Novembre 1790 : L'Assemblée Constituante, par décret, envoya quatre commissaires dans les îles afin de procéder provisoirement à leur administration et à leur organisation.
Le 12 Mars 1791 : Les quatre commissaires arrivent en Martinique.
Les 13, 15 et 29 Mai 1791 : Avant sa séparation, l'Assemblée Constituante décreta que les gens de couleurs, nés de pères et de mères libres, et ayant les qualités requises, jouiraient des droits des citoyens actifs et seraient admis comme les blancs, dans les assemblées paroissiales et coloniales.
Le 30 Septembre 1791 : L'Assemblée Constituante fit place à l'Assemblée Législative.
Le 24 Mars 1792 : L'Assemblée Législative émit un décret stipulant que l'on procéda sur le champ à la réélection des Assemblées Coloniale et des Municipalités et que tous les hommes libres de toutes couleur pourraient être admis à voter dans les Assemblés Paroissiales et seraient éligibles à toutes les places. Quatre commissaires furent nommés pour les Îles du Vent, avec le pouvoir de ramener l'odre et la paix par tous les moyens.
Le 11 Août 1792 : L'Assemblée Législative supprime la prime d'encouragement à la traite, accordée par le Roi Louis XVI, en 1784.
Septembre 1792 : La frégate "La Calypso" envoyé de Guadeloupe, annonça la fausse information venue de l'île anglaise de Mont-Serrat, annonçant que la royauté était rétablie en France.
L'oligarchie créole en place, qui avait pris fait et cause pour la révolution, comme en Guadeloupe, dévoila ses vrais attaches, en jurant fidélité au Roi.
Mais en France, le Roi Louis XVI était enfermé dans la prison du Temple.
Le 16 Septembre 1792 : Les commissaires mandatés par l'Assemblée Législative sont repoussés à coups de canons.
Quand La Guadeloupe et la Martinique apprirent la vérité, elles restèrent fidèles au monarque et contractèrent un pacte de protection mutuelle.
Elles envoyèrent chacune un député en France, avec pour mission de soutenir la royauté. Dubuc fils pour la Martinique et Clairfontaine pour la Guadeloupe.
Le 20 Septembre 1792 : L'Assemblée Constituante met fin à ses travaux. Elle est remplacé par la Convention le 22 septembre; qui proclame aussitôt la République.
Le 1er Décembre 1792 : Le capitaine Lacrosse chargé d'apporter aux Îles du vent, la nouvelle. Il ne peut débarquer en Martinique.
Le 10 et 13 Décembre 1792 : La Guadeloupe et la Martinique, par arrété, déclarèrent la guerre à la France R épublicaine.
Cette même année, la montagne Pelée entra en éruption.

1793 : Le
vicomte Jean - Marie Donatien de Vimeur, Vicomte
de Rochambeau est envoyé comme gouverneur de la Martinique.
1794 : La
convention vote l'abolition de l'esclavage.
23 mars 1794 : Occupation Anglaise de la
Martinique. Cette invasion fut à l'instigation des planteurs.
1796 : En France, la Convention Nationale et remplacée par le Directoire.
Le 25 mars 1802 : Le traité d'Amiens rend l'île
à la France.
Avril 1802 : L'Amiral Louis Thomas Villaret de Joyeuse est nommé Capitaine-Général de la Martinique.
Le 20 Mai 1802 : Napoléon Bonaparte qui dirige la France et l'Empire colonial, rétablit l'esclavage et la traite des noirs conformément aux lois de 1789.
Le 2 Juillet 1802 : Un arrêté renouvelle la déclaration royale de 1777, interdisant le territoire continental aux individus de couleur et l'aggravant par la peine de la déportation.
Le 19 Février 1803 : Un arrêté met en vigueur dans les îles, le Code de la Louisiane. Un article de ce code interdit le mariage entre blanc et noir.
Le 29 Janvier 1809 : Les anglais attaquent la Martinique.
Le 24 Février 1809 : Le Gouverneur
Villaret de Joyeuse capitule, après avoir subi de terrible canonades anglaises dans le Fort Bourbon. Il se résout à capituler; livrant la Martinique aux anglais.
Le 30 Mars 1814 : Le traité de Paris mit fin à la guerre entre la France et l'Angleterre, et rendit la Martinique.
Le 8 Février 1815 : Lord Castlereagh, au nom de l'angleterre, fit signer aux représentants français, ainsi qu'à d'autres représentants de divers pays, réunis au congrès de Vienne, l'abolition de la traite des esclaves, comme "contraire aux principes d'humanité et de morale universelle".
Le 1er mars 1819 : Introduction de l'octroi de mer en Martinique. Cette
taxe est perçue dès l'entrée dans la mer des
Antilles. Elle figure dès lors parmi les recettes des communes
et existe encore aujourd'hui.
Le 14 Octobre 1822 : Une sévère répression contre les esclaves, que l'on soupçonnait de conspirer afin de faciliter le débarquement des troupes du président haïtien Boyer; provoqua un soulèvement sur l'Habitation Lévignan au Carbet.
Cette révolte fut matée dans le sang, exécutions sommaires et jugement expéditifs.
Le 16 Septembre 1824 : Louis XVIII mourut, Charles X monta sur le trône de France.
Le 5 Février 1826 : Une ordonnance permit l'importation dans les îles de certaines marchandises et l'entrée de bâtiments étranger dans les eaux territoriales française.
Le 25 Avril 1827 : une prescription est faite aux tribunaux, d'agir sévèrement contre ceux qui se livrent à la traite.
Le 2 Novembre 1830 : L'affranchissement moral de la classe des gens de couleur libres est promulgué; abolissant les réglements qui leurs ôtaient les droits de citoyen, en les assimilant pleinement à la classe blanche.
Le 17 Février 1832 : Les services de la colonie sont enrichis par la création des Comités d'hygiène.
Le 8 Mars 1832 : Une loi déclara libres, les noirs qui seraient trouvés à bord de navires négriers.
Le 12 Juillet 1832 : Une Loi simplifia les formalités pour l'affranchissement des esclaves.
Le 8 Novembre 1832 : Création des Chambres d'Agricultures.
Le 30 Avril 1833 : Par ordonnance royale, la France abolie les peines de la mutilation et de la marque des esclaves.
Le 28 Aout 1833 : L'Angleterre est le premier pays à décréter l'abolition de l'esclavage sur ses colonies.
Le 29 Avril 1836 : Une ordonnance stipule qu'un habitant des colonies amenant en France, avec lui un esclave del'un ou l'autre sexe, celui-ci serait affranchi selon l'ordonnance du 12 Juillet 1832. La même ordonnance indiquait les noms et prénoms à donner à ces esclaves libérés.
Le 11 Juin 1839 : Une ordonnance royale impose le recensement de tous les esclaves des colonies.
Le 14 Mai 1844 : Le gouvernement présenta à la chambre des pairs, un projet de loi amendant celle du 23 Avril 1833, et attribuant aux tribunaux les manquements aux soins, à l'entretien et, la consommation de violence et de cruauté envers les esclaves.
Le 24 Février 1848 : La révolution entraine la chute de la monarchie de Juillet.
Le 4 Mars 1848 : Le gouvernement povisoire nomme une commission pour l'émancipation et déclare :
"que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves"
Le 27 avril 1848 : Sur proposition de Victor Schoelcher, le décret d'abolition définitive de l'esclavage est signé et appliqué.
Les 22 Mai 1848 : En Martinique, le ton monte. Des troubles
éclatent sur les habitations de l’île, les
esclaves, ayant eu vent de ce qui se trame en métropole,
ne souhaitant pas attendre. Les nègres ont brisé leurs chaînes ("Nèg pété chenn"). C’est la révolte, qui
trouve son point culminant avec la lutte
armée des esclaves de Saint-Pierre.
Le 23 mai 1948 : Le gouverneur Rostoland proclame l'abolition de l'esclavage.
La décision locale d’abolition permet aux Martiniquais de proclamer leur fierté d’avoir pris leurs affaires en main à un moment crucial.
Le 3 Juin 1848 : Le commissaire général, François Auguste Perrinon, mûlatre de Saint-Pierre et membre de la commission du 4 Mars 1848, arrive en Martinique avec le décret officiel du 27 Avril 1848.
L'article 1er, du décret fut modifié
pour les Antilles, en instituant immédiatement l'abolition de l'esclavage, sans tenir compte du délai de 2 mois, initialement prévu pour l'application.
72000 esclaves accèdent ainsi au statut d'hommes libres.
Le 26 Juin 1848 : La révolution socialiste, dites Journées de Juin, fut réprimé par la Garde Nationale et par l'armée, commandé par Louis Eugène Cavaignac.
Le 24 Juin, l'Assemblée nationale, par décret, lui délégua tous les pouvoirs exécutifs.
Le 28 Juin, il démissionna de son poste, mais l'Assemblée lui confia de nouveau le pouvoir exécutif avec le titre de président du conseil des ministres.
Le 10 Décembre 1848 : Louis-Napoléon Bonaparte est élu Président de la République.
Le 12 Mars 1849 : Le Président de la République nomma par arrêté, Gouverneur Général des Antilles françaises, le Contre-Amiral Bruat. Il se substitua au commissaire Perrinon.
Le 15 Mars 1849 : La nouvelle loi électorale ordonna la constitution d'une nouvelle Assemblée législative, accordant à la Guadeloupe et à la Martinique 2 représentants.
Le 9 Juin 1849 : L'élection législatives de la Martinique fut favorable à Mr Bissette, grâce aux planteurs.
Le 12 Juillet 1850 : En Martinique, trois évêchés sont instaurés par décrets.
1851 : Première éruption
de la montagne Pelée. Les premiers indiens et les premiers
chinois arrivent à la Martinique pour pallier au manque
de main d'oeuvre locale et aussi pour reconstruire le Nord dévasté.
Le 12 Juillet 1850 : Trois évêchés sont instaurés par décrets, en Guadeloupe.
Le 2 Décembre 1851 : Louis-Napoléon éxécute un coup d'état. Le régime impérial est rétabli. La période du Second Empire est marquée
par un retour au centralisme annihilant toute trace du pouvoir
local, sinon celui du conseil général aux pouvoirs
élargis, mais entièrement soumis à l’autorité du gouverneur.
Le 6 mai 1853 : Premier convoi d'immigrants Indiens.
1857 : Début de l'immigration des Africains.
1859 : Début de l'immigration Chinoise.
Le 24 octobre 1860 : Un décret impérial permet la constitution de la Société de crédit colonial.
"Le Crédit colonial, qui octroie des prêts pour la construction de sucreries ou pour le renouvellement et l'amélioration de l'outillage, connaît un grand succès. Cependant l'objet de la société se révèle vite trop limité."
(Source : Archives nationales)
Le 2 Janvier 1861 : Le Député Perrinon décéda à Grand-Case, en Martinique.
Le 31 août 1863 : Le crédit colonial est transformé en Crédit Foncier Colonial.
"Le CFC se révèle impitoyable pour les mauvais payeurs : le non paiement d'un semestre d'annuité et la procédure d'expropriation forcée était immédiatement enclenchée, débouchant irrémédiablement sur la ruine du débiteur défaillant."
(Source : crdp Martinique)
Le retour des institutions républicaines, progressif entre
1870 et 1885, apporte le bouleversement que constitue la mise
en œuvre du suffrage universel.
Les citoyens choisissent librement leurs députés,
leurs conseillers généraux et leurs conseillers
municipaux. Les sénateurs sont élus au suffrage
indirect.
La bourgeoisie de couleur occupe progressivement la représentation
politique.
Le 4 Septembre 1870 : Les Prussiens font prisonnier Napoléon III, à Sedan. Lorsque les Parisiens furent au fait de la nouvelle; ils proclamèrent la 3ème République.
Le 24 Septembre 1875 : La loi accorda un Député et un Sénateur à la Guadeloupe.
Le 12 Juin 1879 : Une commission coloniale était instituée en Martinique. Elle fonctionnait entre les sessions du Conseil Général avec des attributions semblables aux Commissions Départementales de France.
Le 21 Juin 1879 : L'organisation des pouvoirs publics des colonies était régis par la même loi qu'en métropole.
Le 27 juillet 1881 : La loi instaure la liberté de la presse
et de l’imprimerie. L’opinion publique se forme sur
fond d’affrontements polémiques des organes de presse
qui se multiplient.
La vie associative prend son essor dans les sociétés
de pensée, les cercles littéraires, les partis politiques
et le mouvement syndical dès les années 1890.
Les années 1900 sont celles des premières grandes
grèves, résultant de la paupérisation du
prolétariat agricole.
1884 : L'immigration indienne est arrêté par le Conseil Général de la Martinique. Depuis 1852 était estimé à 25 500 personnes. 4 551 indiens, au terme de leur contrat d'engagement, avaient demandé à être rapatriées.

Le XXè siècle, débute
durement à la Martinique avec l'éruption
de la Montagne Pelée; le 8 mai à 7H50 du matin,
Saint-Pierre et le Prêcheur sont rayés de la carte.
Fort-de-France devient alors la première ville de la Martinique.
1914-1918 : La première guerre mondiale
et la mobilisation des conscrits.
La participation de jeunes Antillais aux combats de la Première
Guerre Mondiale (les deux tiers furent tués, blessés
ou faits prisonniers) renforce une revendication assimilationiste
qui s’exacerbe au cours du XXème siècle.
On peut citer parmi ses plus ardents porte-paroles, qui feront
écho jusque dans les allées du parlement français,
Joseph Lagrosilière, Allègre, Henri Lemery.
Néanmoins, la première guerre mondiale permet à
la Martinique d’exporter massivement du rhum, qui vient
réchauffer les cœurs et les corps des poilus dans
les tranchées; et cela, jusqu’en 1922.
1929-1932 : Réveil de la montagne
Pelée, moins important qu'en 1902.
En 1938 : Le conseil général
de la Martinique se prononce à l’unanimité
en faveur d’une assimilation intégrale au statut
départemental.
Cette revendication devra attendre la fin de la Seconde Guerre
Mondiale pour se réaliser.
Les leaders communistes d’après guerre, Aimé
Césaire, Léopold Bissol, Georges Gratiant, remportent
des victoires électorales en Martinique.
Ils portent une proposition de loi à l’Assemblée
Nationale. La question est débattue au Parlement, avec
un rapporteur illustre, le jeune député-maire de
Fort-de-France, Aimé Césaire :
" …Les propositions de lois qui vous sont soumises
ont pour but de classer la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion,
et la Guyane française proprement dites en départements
français. Avant même d’examiner le bien fondé
de ce classement, vous ne pouvez manquer de saluer ce qu’il
y a de touchant dans une telle revendication des vieilles colonies.
A l’heure où çà et là des doutes
sont émis sur la solidarité de ce qu’il est
convenu d’appeler l’empire, à l’heure
où l’étranger se fait l’écho
des rumeurs de dissidence, cette demande d’intégration
constitue un hommage rendu à la France, et à son
génie, et cet hommage dans l’actuelle conjoncture
internationale prend une importance singulière (…).
On ne fait rien quand on a la géographie contre soi. Or
en la circonstance, ce n’est pas seulement l’histoire
que nous avons avec nous, c’est aussi la géographie.
En effet, en affirmant le principe de l’unité française
et de l’extension du régime de la loi à des
territoires qui jusqu’ici ne relevaient que du régime
des décrets, les propositions qui vous sont présentées
n’empêchent pas de laisser éventuellement aux
conseils généraux certains pouvoirs qui leurs seraient
propres ". J.O. des débats de l’Assemblée
Nationale Constituante n°23 du 13/03/46 et 25 du 15/03/46.
1940-1943 : Les sombres "années
de l'Amiral Robert"; ou les Antilles sous la poigne du représentant
du gouvernement de Vichy. Des dissidents martiniquais gagnent
Sainte-Lucie afin de rejoindre les forces du Général
de Gaule. Un blocus est instauré autour de la Martinique
1943 : La Martinique se rallie à
la France libre.
1951 : Passage du premier cyclone baptisé,
"Dog".
1946 : Vote de la loi de départementalisation
du 19 mars 1946. La Martinique devient un département français,
représentée par quatre députés et
deux sénateurs.
Ce nouveau statut apporta une certaine richesse économique,
mais la situation sociale ne s'améliora que lentement et
à travers une succession de nombreux conflits sociaux (1948,
1954, 1956, etc.).
1947 : Pierre Albert Trouillé est
le premier préfet de l’île.

1958 :
Aimé
Césaire, député-maire de Fort-de-France,
fonde le PPM (Parti progressiste martiniquais). les martiniquais
choisirent, par référendum, de rester attachés
à la France.
1960 : La Ve République fait entrer
l'outre-mer dans l'ère de la "départementalisation
adaptée".
En 1963 : le gouvernement français
créa le BUMIDOM, le Bureau des migrations des départements
d'outre-mer, afin de soulager la région du fardeau démographique
et de l’accroissement du chômage: le départ
annuel de 10 000 Antillais vers l'Hexagone, afin d’occuper
des fonctions subalternes dans la fonction publique (PTT, hôpitaux,
administrations diverses), a constitué une solution temporaire,
sans que les problèmes de fond n’aient été
abordés.
La décennie soixante-dix vit la montée de revendications
indépendantistes nourries à la fois par le marxisme
et par le modèle cubain.
1972 : La Martinique est transformée
en une région ''mono-départementale''.

1973 : Alfred
Marie-Jeanne crée avec Lucien Veilleur, Marc Pulvar
et Garcin Malsa (ancien du groupe Zanma) le mouvement "La
Parole au Peuple".
1974 : La Martinique devient région,
statut qui se superpose à celui de DOM.
1978 : Alfred Marie-Jeanne fonde le Mouvement
Indépendantiste Martiniquais avec pour objectif : la décolonisation
et l'indépendance de la Martinique.
1982 : Création de l' Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou ANT. Cet organisme public français est chargé d'accompagner les migrations des résidents de l' outre-mer français, cherchant une qualification ou une insertion professionnelle ailleurs.
Le 2 mars 1982 : Les mouvements indépendantistes connurent un certain apaisement lors de l’adoption de la loi, qui érigeait la région
en collectivité territoriale et faisait de la Martinique
une des 26 Régions françaises.
Les élites politiques martiniquaises reçurent alors
un surcroît de responsabilités dans le développement
économique de leur département, qui devint largement
subventionné à la fois par l'État français
et par l'Union européenne.
Cependant, la transformation de l'économie et de la société
martiniquaise, bien que nécessaire en raison de l’effondrement
de l’industrie sucrière, s’avéra difficile
pour la population qui a dû se rendre à l’évidence
: l'ancienne économie basée sur une agriculture
d'exportation (banane, rhum et canne à sucre) n'avait plus
qu'un avenir fort limité en Martinique.
Dorénavant, l’industrie prometteuse, c’est
davantage le tourisme et l’industrialisation.
1983 : La décentralisation impose
la création des conseils régionaux.
1985 : Agitations autonomistes.
1986 : Camille Darsières succède
à Aimé Césaire au Conseil régional.
1992 : Claude Lise est élu au Conseil
régional.
1994 : La Martinique penche toujours à
gauche : le Conseil régional est présidé
par un communiste et dominé par le PPM, alors que le Conseil
général est présidé et dominé
par le PPM.
1996 : Le rhum agricole de la Martinique a obtenu une "AOC Martinique" (par le décret du 5 novembre 1996).
L'AOC Martinique
est délimitée à l'intérieur du territoire de vingt-trois communes :
-
Arrondissement de Fort-de-France : les communes du Carbet, de Fort-de-France, du Lamentin, de Saint-Joseph, de Saint-Pierre.
- Arrondissement de La Trinité : les communes de Basse-Pointe, de Gros-Morne, du Lorrain, de Macouba, du Marigot, du Robert, de Sainte-Marie, de La Trinité.
-
Arrondissement du Marin : les communes du Diamant, de Ducos, du François, du Marin, de Rivière-Pilote, de Rivière-Salée, de Saint-Esprit, de Sainte-Luce, des Trois-Ilets, du Vauclin.
La Martinique est actuellement le seul départenent d'outre-mer a obtenir une AOC pour son rhum.
1997 : Elections législatives :
deux députés de droite (Anicet Turinet et Pierre
Petit), un député indépendantiste, Alfred
Marie-Jeanne et un député PPM, Camille Darsière.
1998 : Le 24/11 Alfred Marie-Jeanne est
élu président de région, il milite avant
tout pour le concept de ;" l'Assemblée unique ".
150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Grève
des ouvriers des plantations de bananes, soutenus par les dockers
de Fort-de-France qui bloquent le port. Nomination d'un nouveau
préfet, Dominique Bellion.
1999 : La banane martiniquaise est au centre
de la bataille commerciale que se livrent les Etats-Unis et l'Europe.
2000 : L'Assemblée nationale adopte
la Loi d'orientation pour l'outre-mer (LOUM) qui institue dans
les DOM un "congrès" aux pouvoirs limités.
2001 : Maire de Fort-de-France depuis 47
ans, Aimé Césaire (87 ans), poéte-apôtre
de la "négritude", laisse la place à Serge
Létchimy, du Parti progressiste martiniquais (PPM), qu'il
a fondé. Le député indépendantiste
et président du Conseil régional Alfred Marie-Jeanne
remporte 39% des voix aux élections municipales.
Aujourd’hui, les Martiniquais ont
définitivement remis en cause la solution de l’émigration
(maintenant disqualifiée) vers la Métropole.
Du côté de l’État français,
le recours systématique aux subventions a fini par devenir
une forme d’assistanat perpétuel dans une île
d’assistés sociaux où le taux de chômage
avoisine les 35 %. Enfin, la problématique identitaire
martiniquaise n’a pas été résolue,
puisque l’assimilation à la culture européenne,
surtout depuis l’intégration à l’Union
européenne, s’avère en totale contradiction
avec la réalité géostratégique de
la Martinique au sein des Antilles.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, les Martiniquais
créolophones s’impliquent davantage dans la gestion
de l'île et la nomination d’un «Métro»
à un poste clé ne va plus de soi.
À ce sujet, les années quatre-vingt-dix ont été
marquées par des grèves dont la revendication principale
portait sur l'égalité des traitements entre Blancs
et Noirs occupant des postes identiques.
8 mai 2002 : Commémoration du centenaire
de l’éruption de la montagne Pelée.
2003 : En Décembre, Les martiniquais
ont décidé de conserver le double statut : département
et région.
2004 : En Février, le 24ème
préfet de la Martinique, Yves Dassonville, vient remplacer
Michel Cadot (2000-2004).
Février 2006 : Le transport des passagers d’Air Caraïbes à destination de la Guadeloupe et des îles environnantes est désormais assuré par la compagnie Air Caraïbes Express, détenue à 80% par les salariés d’Air Caraïbes.
Mars 2006 : La filiale antillaise de Bouygues Télécom est rachetée 155 millions d’euros par le groupe Digicel, présent dans 15 pays de la Caraïbe et plus important opérateur de la zone.
Avril 2006 : La ville de Fort-de-France est sélectionnée pour l’expérimentation du WIMAX (transmission hertzienne de données à haut débit). Ce projet de 0,4 million d’euros est essentiellement porté par le Feder (45%) et la ville capitale (36%).
Juin 2006 : Premier atterrissage du Boeing 777 d’Air France à l’aéroport du Lamentin.
Juillet 2006 : Premier forum altermondialiste caribéen organisé à la Martinique et rassemblant des délégations de l’ensemble de la zone.
Octobre 2006 : Découverte de nappes phréatiques à Saint-Pierre. Après étude, l’exploitation de la ressource complètera l’approvisionnement des communes du Nord Caraïbe.
Fermeture de l’Akena Foyatel à Fort-de-France et persistance de la crise à l’hôtel Caritan, mis en redressement judiciaire depuis 2005.
Novembre 2006 : Dixième anniversaire de l’obtention du label AOC pour les rhums de la Martinique.
Le groupe Fram cède l’hôtel Batelière au groupe Monplaisir. L’aéroport du Lamentin est en voie d’être renommé « Aéroport Martinique Aimé Césaire » et se dote de bornes Air France d’enregistrement en libre-service.
Décembre 2006 : Sky Services met en place une liaison aérienne directe entre Montréal et Fort-de-France.
L’incinérateur de déchets de la Trompeuse à Fort-de-France reçoit la certification ISO 14001.
Nouveau régime de l’aide compensatoire : les planteurs européens recevront 280 millions d’euros en 2007, dont 129 millions pour les DFA.
Le pôle Innovation et Entreprise de la Cacem reçoit le label « Centre européen d’entreprise et d’innovation ». Il rejoint les 34 CEEI de France et les 230 d’Europe, réunis au sein du réseau European Business and Innovation Centre Network.
Le vendredi 17 Aout 2007 : le cyclone Dean balaye la Martinique.
Le sud et le centre de l'île sont particulièrement touchés. Il laisse un triste résultat dévastateur, 100% des cultures bananières et 70% des cultures cannières ravagés.
Au dégâts matériels et immobiliers, on déplore deux morts et six blessés.
