Pour un soucis de précision, je me dois de reprendre l'intégralité
du texte sur la société, du ministère de
l'Outre-Mer.
Merci de votre compréhension.
Au sommaire :
Population
Enseignement
Environnement
Santé
Social
Politique
Religions
Vie culturelle
Les costumes
Traditionnels
Fêtes
Dessertes aérienne
et maritime
Médias
Population

La société martiniquaise est issue du métissage
de divers groupes humains: les
esclaves de l'Afrique noire, les premiers colons européens,
les travailleurs hindous, les Syriens et les Chinois.
La population martiniquaise est estimée, par l'INSEE, à 393000 habitants au 1er janvier 2004; contre 381 427 habitants en 1999, 359.600 en 1990 et 328.600 en 1982.
Sur la période 1999-2003, la Martinique a connu une croissance démographique contenue.
Répartie sur 1.128 Km²,la population est très
dense, 357 habitants au Km², contre 106 au niveau national.
Les populations se concentrent à la périphérie des centres urbains.
Les principales villes sont (chiffres de 1999) la capitale administrative
et économique, Fort-de-France (94.049 habitants), Le Lamentin
(35.460 habitants) et Schoelcher (20.845 habitants).
Ces trois communes forment le principal pôle de peuplement
et d’activité de l’île, les communes
de Trinité, du Marin et du François constituant
les principaux pôles locaux.
La population de la Martinique est relativement jeune et dynamique,
avec 30,3 % de moins de 20 ans, 53,8 % de personnes âgées
de 20 à 59 ans et 20,3 % de plus de 60 ans. L’espérance
de vie est élevée, ainsi que le nombre de centenaires,
plus élevé que la moyenne nationale.
Enseignement

L’enseignement public en Martinique est le même qu'en
métropole et suit un calendrier identique.
En 2001, l'enseignement
du premier degré public et privé (écoles
maternelles et primaires) a accueilli 52 462 élèves
dans 280 établissements. L'enseignement du second degré
(public et privé) a accueilli environ 52 000 élèves
dans 80 établissements. Deux lycées d'enseignement
agricole permettent de préparer un BEPA (Brevet d'Enseignement
Professionnel Agricole) d'exploitation (spécialité
: agriculture des régions chaudes ; dominante : floriculture
de plein champ et sous abri, élevage bovin et avicole),
un BEPA Services (dominantes : secrétariat, accueil - ventes
de produits horticoles et de jardinage), ainsi qu'un BTA (Brevet
de technicien Agricole) option Services.
L'université Antilles-Guyane dispense un enseignement
en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le campus de Schoelcher en
Martinique regroupe un peu plus de 5000 étudiants répartis
dans :
- Une UFR (Unité de Formation et de Recherche) de lettres
et sciences humaines (niveau maîtrise et préparation
aux concours d'agrégation de lettres modernes) ;
- Une UFR de droit et économie (niveau DEA et DESS, préparation
aux concours d'entrée aux IRA, au centre de formation professionnelle
d'avocats et à l'Ecole nationale de la magistrature).
- Une UFR de médecine filière résidant médecine
générale et internat médecine spécialisée.
Un Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM)
a été ouvert en 1992.
A la rentrée 2005-2006, les services statistiques du Rectorat de la Martinique recensent
348 établissements scolaires publics et privés, répartis comme suit :
L’essentiel (91,6%) de ces établissements émane du public. Parmi les établissements privés, seuls 1,1% ne sont pas sous contrat avec l’Education Nationale. Ils représentent en outre 5,1% des établissements du premier degré et un quart des établissements du
second degré.
En 2006, cinq Zones d’Education Prioritaires (Zep) ont été instituées. Elles regroupent 85 établissements scolaires, soit 24,4% du total et 16 308 élèves (16,5% des élèves des premier et second degrés en 2005-2006).
Le nombre total d’élèves recensés à la rentrée 2005-2006 s’établit à 107 088, en recul annuel de 1%. La grande majorité (92%) d’entre eux relève des premier et second degrés, même si leur nombre est en repli, de même que celui des étudiants de l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG)101. A l’opposé, le nombre d’élèves inscrits dans les trois établissements relevant du Ministère de l’Agriculture et les trois Centres de Formation d’Apprentis enregistre une hausse annuelle de 8,2%.
La seconde générale et technologique demeure le choix privilégié des élèves après la troisième. 3 937 élèves y ont été affectés en juin 2006, soit 54,4% des élèves. Après la
troisième, le choix se porte ensuite vers le BEP (un tiers des élèves affectés) et le CAP
(11,1%). S’agissant des options disponibles en seconde, la quasi-totalité des élèves opte pour
une deuxième langue vivante. Par ailleurs, si les sciences médico-sociales et les mesures
physiques et informatiques demeurent très demandées, la biologie et la physique-chimie ont
connu un regain d’intérêt en 2006. D’autre part, les lycées de Bellevue et de Trinité demeurent
les établissements les plus demandés.
En 2006, 3 805 élèves se sont portés candidats à l’entrée en CAP et en BEP, pour une
capacité d’accueil de 3 362 places (en repli annuel de 2,7%). Le Rectorat note en outre que les
jeunes ayant achevé leur terminale de CAP sont de plus en plus nombreux à vouloir compléter
leurs études par un BEP. La préférence des élèves va surtout vers les métiers du tertiaire
(restauration, mécanique automobile et nautique), au détriment des métiers de l’industrie et de
l’artisanat (ébénisterie, travail de l’aluminium…) et de la construction.
La session 2006 du baccalauréat a
dénombré 5 920 candidats inscrits, soit une
hausse annuelle de 2,1%. Ce sont les candidats
au baccalauréat professionnel qui ont
enregistré la progression la plus notable
(+17,5% sur un an). Cette dernière porte leur
part dans l’ensemble des candidats à 27%.
Dès lors, les trois filières (générale,
technologique et professionnelle) comptent
chacune environ un tiers des inscrits en 2006.
Comme au cours des années précédentes, ce
sont les séries S (40,3% des candidats de cette
filière) et STT (68,3%), ainsi que les options
commerce (22,9%), comptabilité (20,7%) et
secrétariat (20,4%) du baccalauréat
professionnel qui ont attiré le plus de
candidats.
Pour la session 2006 du baccalauréat, le taux de réussite global continue à croître pour
s’établir à 78,6% pour le baccalauréat général, 65,6% pour le baccalauréat technologique et
60,8% pour le baccalauréat professionnel. Les résultats demeurent cependant en-deçà des
résultats nationaux.
En 2006, l’Académie de la Martinique
comptait 10 079 employés, soit presque autant
qu’en 2005. Le personnel enseignant
concentre à lui seul 82% des employés et
relève pour l’essentiel du second degré. Par
ailleurs, la part des personnels autres
qu’enseignants continue à croître pour
atteindre 18% en 2006.
En savoir plus :
Académie
de la Martinique
Université des
Antilles-Guyane

Environnement

La Martinique dispose d'un patrimoine naturel très riche.
Celui-ci fait l'objet d'une politique active de protection. Une
cartographie générale des espaces naturels protégés
a été établie en 1993.
Le volcan de la Montagne Pelée est parti intégrante
du Parc Naturel Régional de Martinique, s'étendant
sur 62 725 ha. Celui-ci est complété par deux réserves
naturelles, l’une recouvrant le site prestigieux de la presque
île de la Caravelle (517 ha), la seconde sur les îlets
de Sainte-Anne. Deux projets sont en cours d’inscription
: il s’agit des sites du Massif de la Montagne Pelée
et de la Baie du Trésor et du cap Salomon.
Le conservatoire du littoral a par ailleurs acquis près
de 1 200 ha sur les sites littoraux les plus remarquables : Grand
Marabout (113 ha), Anse-Couleuvre (509 ha), Pointe Rouge (55 ha),
presqu’île La Caravelle (257 ha), Morne Larcher (64
ha) et Cap Salomon (37 ha).
De nombreux projets sont en cours, en particulier la création
d'un réseau de réserves biologiques domaniales sur
la partie forestière centrale et de réserves naturelles
marines. Les presqu'îles de la Caravelle, du Diamant et
de Sainte-Anne, font l'objet également de projets de classement-site
au titre de la loi du 2 mai 1930. Enfin, de nombreux organismes
de recherche sont actifs dans le domaine de l'environnement, notamment
l'Observatoire volcanologique de la Montagne Pelée, l'IRD
(Institut de Recherche pour le Développement), IFREMER,
CIRAD, INRA, etc.
En savoir plus :
Direction
Régionale de l’Environnement de la Martinique
Santé

La Martinique est équipée d'infrastructures sanitaires
complètes : un centre hospitalier régional et universitaire
à Fort-de-France doté d'un plateau technique moderne,
13 hôpitaux généraux, 3 maternités
publiques et 2 maternités privées.
Il existe en outre un centre hospitalier spécialisé
en rééducation fonctionnelle.
Les principaux cantons sont dotés d'un dispensaire.
De plus, la région compte 3 cliniques privées (soins)
et une clinique de repos et de convalescence.
La formation de sages-femmes, d'infirmiers, d'auxiliaires de puériculture
est assurée par des écoles professionnelles publiques.
Aucune maladie tropicale majeure n'est signalée en Martinique.
Aucune vaccination spécifique n'est exigée.
Au 1er janvier 2005, les services de la Direction de la Santé et du Développement Social
(DSDS) recensaient 4 364 professionnels de santé, en hausse de 4,4% sur un an. Les infirmiers
forment l’essentiel du corps de métier (54%).
La densité des personnels de santé, inchangée en 2005, demeure inférieure à celle de la
France hexagonale. Ainsi, la Martinique compte 85 médecins généralistes libéraux pour
100 000 habitants, contre 113 dans l’hexagone mais 73 dans l’ensemble des DOM. Par ailleurs,
la proportion de médecins généralistes libéraux de plus de 55 ans est plus importante à la
Martinique qu’au plan national (32,5% contre 23,9%).
Social

La sécurité sociale s'applique comme en métropole
en matière d'assurance maladie, d'accidents du travail
et d'assurance vieillesse. La couverture sociale est la même
que dans un département métropolitain.
Les allocations familiales sont alignées sur le niveau
métropolitain. Les prestations sociales telles que l'allocation
pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation
ont été également alignées ou étendues
dans les mêmes conditions qu'en métropole. Cependant,
des mesures spécifiques subsistent :
- L’allocation familiale au premier enfant au-delà
de 3 ans ;
- Le complément familial de 3 à 5 ans ;
- La prestation de restauration scolaire.
L'aide sociale (à la famille, aux personnes âgées)
est active et en grande partie décentralisée.
Le taux du SMIC est aligné sur celui de la Métropole,
ainsi que le Revenu Minimum d’Insertion (RMI).
Depuis 1995, un établissement public, l’agence d’insertion,
est chargée de piloter le dispositif d’insertion
et de définir le programme départemental d’insertion
et le programme de tâches d’utilité sociale.
Au 31 décembre 2004, la Martinique comptait 38020 demandeurs d'emploi de catégorie 1, soit 0,7% de plus en six ans. En juin 2004, l'indicateur de chômage s'est établit à 23,7% de la population active, soit 160600 habitants.
En 2006, la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) a versé quelques 536,7 millions
d’euros (+5,7% sur un an) à 95 587 bénéficiaires (+0,5%). Ce sont les prestations familiales et
les mesures d’aide à l’invalidité et à la précarité qui expliquent l’essentiel de l’évolution
annuelle des montants comme des bénéficiaires.
Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) compte à lui seul pour un tiers des montants
versés par la Caf, de même que les bénéficiaires de cette allocation contre la précarité représentent un tiers des bénéficiaires des aides de la Caf. En 2006, le nombre d’allocataires du
RMI a reculé de 0,3%, tandis que les montants correspondants augmentaient de 2,3%.
Politique

A la fin de la guerre, les communistes vont devenir la première
force politique de l'île. Léopold Bissol et Aimé
Césaire sont élus députés, Thélus
Léro sénateur. Ils remportent 14 sièges au
Conseil Général. En France les communistes sont
majoritaire à la Chambre des Députés et les
deux députés communistes martiniquais vont profiter
de cette aubaine pour faire voter la loi 19 mars 1946 dont Aimé
Césaire à été le rapporteur. Le vieux
rêve assimilationniste est enfin réalisé en
dépit des nombreuses réticences en France et dans
la ploutocratie Béké (Système politique dont
le pouvoir est exercé par le groupe financièrement
le plus riche).
1946 : La loi du 19 mars érige la
Martinique en Département d'Outre-Mer. Sa mise en oeuvre
sera effective à partir du 1er janvier 1947. Le 16 août
1947, Pierre Trouillé est nommé premier Préfet
de la Martinique. Création la même année de
la Caisse Générale de Sécurité Sociale
après de longues batailles.
1958 : Création d'une fédération
de l'U.N.R en Martinique. Naissance officielle du mouvement gaulliste
en Martinique. Après l'abandon par les communistes de l'idéologie
assimilationniste, le partisans de l'assimilation changent de
camp, désormais se sont les représentants de la
bourgeoisie mulâtre admirateurs du Général
de Gaulle qui défendront l'assimilation avec conviction
à partir des années 60. Ses plus illustres défenseurs
sont les députés Camille Petit et Victor Sablé,
le sénateur Georges Marie-Anne, Emile Maurice, Michel Renard
et Edmond Valcin etc...
1963 : Le gouvernement français
créa le BUMIDOM, le Bureau des migrations des départements
d'outre-mer, afin de soulager la région du fardeau démographique
et de l’accroissement du chômage.
1964 : Scène de liesse populaire
lors de la visite du Général de Gaulle à
Fort de France. Le Général de Gaulle est l'objet
d'un véritable culte en Martinique. Création du
quotidien France Antilles et ouverture d'une chaîne de télévision
française en Martinique l'O.R.T.F pour étouffer
les velléités séparatistes dans l'île.
1972 : La Martinique est transformée
en une région ''mono-départementale''.
1973 : Alfred Marie-Jeanne crée
avec Lucien Veilleur, Marc Pulvar et Garcin Malsa (ancien du groupe
Zanma) le mouvement "La Parole au Peuple".
1974 : La Martinique devient région,
statut qui se superpose à celui de DOM.
1975 : Le 1er janvier I..E.D.O.M met en
circulation dans les D.O.M les billets de banque qui sont en cours
en France.

1978 : Alfred
Marie-Jeanne fonde le Mouvement Indépendantiste Martiniquais
avec pour objectif : la décolonisation et l'indépendance
de la Martinique.
1983 : Application en Martinique des lois
de Décentralisation. Création comme en France d'une
nouvelle institution, le Conseil Régional.
1994 : La Martinique penche toujours à
gauche : le Conseil régional est présidé
par un ;communiste et dominé par le PPM, alors que le Conseil
général est présidé et ;dominé
par le PPM.
1996 : L'égalité sociale
entre la France et les D.O.M est réalisée sous la
présidence de Jacques Chirac. Alignement du S.M.I.C des
D.O.M sur celui de la France.
1997 : Elections législatives :
deux députés de droite (Anicet Turinet et Pierre
Petit), un ;député indépendantiste, Alfred
Marie-Jeanne et un député PPM, Camille Darsière.
1998 : Le 24/11 Alfred Marie-Jeanne est
élu président de région, il milite avant
tout pour le concept de ;" l'Assemblée unique ".
2000 : L'Assemblée nationale adopte
la Loi d'orientation pour l'outre-mer (LOUM) qui institue dans
les DOM un "congrès" aux pouvoirs limités.
2001 : Maire de Fort-de-France depuis 47
ans, Aimé Césaire (87 ans), poéte-apôtre
de la "négritude", laisse la place à Serge
Létchimy, du Parti progressiste martiniquais (PPM), qu'il
a fondé. Le député indépendantiste
et président du Conseil régional Alfred Marie-Jeanne
remporte 39% des voix aux élections municipales.
Fin 2003 : Les martiniquais ont décidé
de conserver le double statut : département et région.
Mai 2004 : Alfred Marie-Jeanne (MIM-CNCP)
est réélu président de la région Martinique.
Le 6 mai 2007 : Au deuxième tour de l'élection présidentielle, les résultat furent de 39,48% pour Mr Nicolas SARKOZY et de 60,52% pour Mme Ségolène ROYAL.
Une déferlante rose submergea l'île.
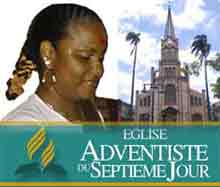
Religions

Les Églises
Adventistes, baptistes, méthodistes, témoins de
Jéhovah... Les micro-Eglises sont ici croyances courantes.
L'hindouisme
Les temples hindous font regretter Bénarès, Au contact
des chrétiens créoles, le shivaïsme s’est
transformé. La grande fête s'appelle tout simplement
Bon Dieu Cooli (le coolie, c'est l'hindou).
La sorcellerie et les superstitions
Vos chances sont minces de croiser un quimboiseur ou un séancier,
l'équivalent de nos ensorcelleurs berrichons. Les recettes
courantes consistent en la confection d'amulettes, de philtres,
de tisanes ou de bains corporels à base d'herbes. Des pratiques
plus noires en appellent à l'aide des morts pour éliminer
un rival.
Dans l'imaginaire antillais, les zombis restent toujours d'actualité…
A ce qu'il parait, à la Jamaïque, il y aurait un village
de morts vivants...
Les rastas
Le « rasta » cache une philisophie passionnante, érigée
en culture et en mode de vie par de nombreux noirs des Caraïbes.
Au quotidien, les rastas, sont avant tout non violents, croient
au pouvoir pacificateur de la musique, observent un régime
alimentaire très strict et préfèrent vivre
sans travailler. Le sound system à fond, les dreadlocks
au vent, ils mènent leur vie à l’écart
de la société de consommation. Ils pratiquent un
jardinage particulier : plantation, culture et consommation de
la ganja (evidemment illégal). Dernière caractéristique
: les rastas ont le temps devant eux, tout leur temps, et même
plusieurs vies.
Vie
culturelle 
La Martinique bénéficie d'une activité culturelle
dynamique : cinémas, représentations théâtrales,
artistes en tournées, expositions, festivals de musique,
manifestations culturelles nationales... sans oublier le Carnaval
pour les fêtes du Mardi-Gras.
A noter le Festival de Fort-de-France, organisé au mois
de juillet par le SERMAC, les festivals internationaux de jazz
et de guitare classique organisés au mois de décembre
par le CMAC-scène nationale.
Le patrimoine historique est bien mis en valeur. Il en est ainsi
du site exceptionnel de la ville de Saint-Pierre, entièrement
détruite en 1902 par l'éruption de la Montagne Pelée
et dont les vestiges ont fait l’objet d’un ambitieux
programme financé par l'Etat et les collectivités
locales. L’île compte de nombreux musées :
musée archéologique de Fort-de-France, musée
de la Pagerie où sont exposés les souvenirs de Joséphine
de Beauharnais, Musée industriel de la canne à sucre,
centre d'art Paul Gauguin, Musée d'histoire et d'ethnographie
de Fort-de-France, Centre culturel de Fonds Saint-Jacques à
Sainte-Marie, Ecomusée de Rivière Pilote...

Les costumes
traditionnels 
Les premiers colons ne donnaient à leurs esclaves que
deux morceaux de tissus pour se couvrir. L’église
trouvant cette tenue indécente, une chemise appelée
vulgairement “trois-trous” (deux pour les bras et
un pour la tête) fût la nouvelle tenue. Petit à
petit, les femmes y ajoutèrent une jupe, puis d’autres
éléments pour arriver aux robes en Madras.
Le tissu Madras provient à l’origine d’Inde
et il est fabriqué à partir de fibres de banane
que l’on peint avec des couleurs vives. Petit à petit,
le coton remplacera le tissu de bananier.
Chaque robe correspond à une activité. Ainsi par
exemple le jupon blanc est utilisé au quotidien, alors
que le jupon coloré est destiné aux grandes cérémonies;
un autre exemple est la gaulle, robe blanche à manches
mi-longues, qui est plutôt une tenue d’intérieur.
Un élément important de la tenue est la coiffe ou
tête. Les jeunes filles portent un carré de tissu
blanc, le madras étant réservé aux femmes.
Là encore, les têtes ont une signification en fonction
du nombre de bouts ou pointes : un bout signifie que le coeur
de celle qui
le porte est à prendre, deux bouts signifient
que ce coeur est déjà pris, trois bouts signifient
que ce coeur est pris mais est ouvert à de nouvelles propositions.
Les bijoux enfin sont, comme les robes portées, une marque
d’évolution sociale.
Historiquement en effet, les femmes créoles obtenaient
de l’or comme récompense de leur travail.
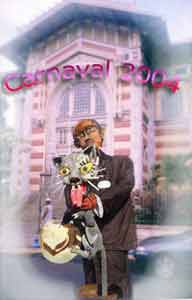
Fêtes

- Le carnaval
est l'événement annuel incontournable, car il fait
partie de la culture créole. Il se déroule du samedi
Gras au mercredi des Cendres.
C’est l’occasion pour tous les martiniquais de se
retrouver dans les rues et de faire la fête. Pendant une
semaine, défilés des reines et des chars, animations
musicales se succèdent pour emmener le roi Vaval vers sa
dernière demeure.
Les voitures se transforment en engin du démon dont le
but est de faire le plus de bruit possible.
Profitez de cette occasion pour admirer les costumes des participants
qui sont toujours magnifiques, laissez vous emporter par les rythmes
créoles et amusez-vous bien !
A chaque jour son thème :
– Samedi et dimanche : libre
– Lundi : Mariages burlesques
– Mardi : Diables rouges
– Mercredi : Enterrement de sa Majesté “Vaval”
en noir et blanc.
Pour des raisons de sécurité, ne vous promenez pas
la nuit pendant le carnaval.

- Les courses de Yoles et de Gommiers
(courses de bateaux) est l’une des activités sportives
traditionnelles de la Martinique. Les gommiers étaient
déjà utilisés par les Amérindiens.
La yole, elle, est la version “moderne” du gommier
puisque c’est une embarcation dotée de voiles qui
le remplaçât et qui fût utilisé par
les pêcheurs dés le XVIIIe siècle.
Les Martiniquais sont donc très attachés à
ces embarcations qui requièrent de la pratique et une
grande habilité. Des courses de yoles et de gommiers sont
organisées tous les ans et ce plusieurs
fois par an. Ne manquez pas ce spectacle magnifique des voiles
de yoles sur la mer des Caraïbes...La plus grande de ces
manifestations est le tour des yoles rondes en août pendant
laquelle les bateaux font le tour de la Martinique en une semaine.
- Nwel,
aux éfluves de cannelle et de vanille.
Dès le premier jour de l'Avent et ce, jusqu'au 25 décembre,
la campagne et les villes résonnent de "Chanté
Nwèl" (cantiques, glorifiant la naissance prochaine
du Christ ruthmé par les Ti-bwas, siyaks, Cha-chas et Gwo-kas,
sur des aires de biguine, de mazurka, etc.... .).
La nuit de Noël, commence obligatoirement, par la traditionnelle
messe de minuit.
Car Noël est avant tout une fête chrétienne
(90% environ de la population est d'obédience chrétienne).
Ensuite, place à la fête et le "chanté
Noël" reprend avec vigueur toute la nuit, on chante
et on festoie grassement de maison en maison, jusqu'au petit matin.
De nos jours, le sapin (de plastique) et la dinde aux marrons
venus tout droit de Métropole, ont un peu modifié
l'image du Noël Tropical, avec la branche de filao décorée
de papier et de rubans de couleurs.

Dessertes
aérienne et maritime 
La Martinique est desservie par 3 compagnies régulières
en direction de Paris (927 000 passagers en 2002) : Air France
(48% du trafic), Corsair (30 % du trafic), AOM, Aérolyon,
Star Europe, American Eagle, Miami Airways, Air Canada, Royal
Air, Air Caraibes, Air Guadeloupe, Cubana et Liat. La desserte
régionale est principalement assurée par la compagnie
Air Caraïbes vers La Guadeloupe, St Martin, Ste Lucie. Air
France assure également une liaison régulière
vers Cayenne. Des vols charters permettent également de
se rendre aux Etats Unis ou au Canada directement à partir
de Fort de France ou bien après une escale à Pointe
à Pitre.
En 2001, le traffic s’est élevé à 1 634
100 passagers correspondants à 37 700 mouvements d’avion.
En 2006, le nombre d’usagers s'est élevé à 1 541 509 contre 1 518 446 en 2005.
En 2006, parmi les événements marquants, il convient de relever :
- la validation du Grand Projet Européen de Transport commun en site propre (TCSP) par les services de la Commission Européenne ;
- la modernisation et la rationalisation du parc aérien sur la desserte des Antilles françaises ;
- la reprise, temporairement remise en cause en 2007, de liaisons régulières avec l’Amérique du Nord par la compagnie aérienne Delta Airlines. Par ailleurs, l’offre de transport aérien vers la Caraïbe et les autres pays de la région a été complétée par l’ouverture de lignes et l’augmentation des rotations sur plusieurs lignes existantes.
Par ailleurs, à compter du 17 janvier 2007, l’aéroport de Fort-de-France – Le Lamentin est rebaptisé Aéroport de Martinique - Aimé CESAIRE.
L’année 2006, est marquée par la poursuite de l’amélioration de l’offre des compagnies aériennes, particulièrement à l’international et dans la Caraïbe, ainsi que par les opérations de maintien du potentiel aéronautique:
- Air Caraïbes Express STAG (Société de Transport de l’Archipel Guadeloupéen), détenue à 80% par des salariés d’Air Caraïbes, assure désormais le transport de passagers entre la Guadeloupe et ses dépendances. En sus de la desserte classique au sein de l’archipel, des vols entre Baillif et Saint Barthélemy sont programmés évitant ainsi un détour par Pointe-à-Pître. Par ailleurs, la commission européenne a autorisé l’aide de l’état français à hauteur de 3,78 millions à Air Caraîbes pour l’achat d’un nouvel avion ATR72-500 qui effectuera les liaisons Caraïbes et qui viendra s’ajouter à la flotte disposant déjà d’un nouvel Airbus A330-300 depuis juin 2006.
- Air France a également entamé en juin 2006, la modernisation et de rationalisation de sa flotte sur la desserte des Antilles françaises par la mise en service de 2 Boeing 777-300 ER neufs qui remplaceront peu à peu les Boeing 747-300. Cette dernière a également signé un accord avec Boeing pour l’achat de sept avions supplémentaires pour le réseau Caraïbes – Océan Indien. Enfin, la compagnie a inauguré deux bornes en libre service afin de permettre à ses passagers détenteurs d’un billet électronique de s’enregistrer de manière autonome ainsi que de procéder à toutes les transactions disponibles sur ce support.
- Suite au renouvellement de sa flotte, et de la mise en service de ses nouveaux B747- 400, Corsair restructure sa classe « Grand Large » en offrant plus d’espace et de confort aux passagers.
- Parallèlement à l’opération « Fly me to Martinique », pilotée par le bureau newyorkais du CMT, l’ouverture de la liaison aérienne Fort de France – Atlanta, assurée par la compagnie américaine Delta Air Lines a eu lieu en décembre 2006. Le Conseil Régional a apporté une caution devant servir à couvrir les pertes éventuelles. La compagnie américaine a également obtenu une baisse des taxes aéroportuaires et la mise à disposition de locaux, gratuits pendant les 6 premiers mois. Toutefois, faute de fréquentation suffisante, Delta Air Lines a suspendu ses vols vers la Martinique et d’autres îles de la Caraïbe depuis fin avril 2007 et ce jusqu’ à mi-juin 2007.
- Les vols de Sky Services, au départ du Québec et à destination de la Martinique et la Guadeloupe, ont été inaugurés en décembre 2006. Toutefois ces derniers ont également été interrompus début 2007.
- Les compagnies anglophones se regroupent (Liat, Caribbean Star) pour mieux desservir le marché régional et la compagnie vénézuélienne Avior Airlines poursuit son développement à la Martinique, en assurant une liaison hebdomadaire versCaracas, offrant ainsi la possibilité de se déplacer plus facilement vers l’Amérique latine.
- La compagnie aérienne martiniquaise Take Airlines poursuit son développement, grâce à de nouveaux avions adaptés aux aéroports de la région. Elle assure désormais elle-même la commercialisation de ses lignes, le partenariat technique avec Air Caraïbes ayant pris fin. La seule compagnie française à desservir les Grenadines sera présente au prochain Salon « Top Résa ».
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de
la CCI :
http://www.martinique.cci.fr/ccim/aeroport/sommaire/frame.htm
De plus, des liaisons maritimes rapides permettent de se rendre
aux îles proches et notamment en Guadeloupe.
Pour le fret, la Martinique est desservi principalement avec des
marchandises conteneurisées, ce qui place le port de Fort
de France à la troisième place des ports français
pour le trafic de conteneurs, derrière La Havre et Marseille.
Pour en savoir plus :
Traffic
maritime
Air Caraibes
Air France
Corsair

Médias

La presse écrite en Martinique compte un quotidien (France-Antilles),
plusieurs hebdomadaires ou mensuels régionaux complétés
par la diffusion des journaux édités en métropole.
Le service public de télévision est assuré
par Réseau France Outre-mer (RFO) sur deux canaux : Télé
Martinique et Tempo. RFO retransmet des programmes de France Télévision,
TF1, d’ARTE et la Cinquième et produit des programmes
régionaux.
Les programmes radio de RFO sont constitués d'émissions
produites localement et d'émissions reprises de Radio France.
Les auditeurs ont aussi le choix entre de nombreuses radios locales
privées.
Deux chaînes de télévision privées,
Antilles-Télévision (A-T-V) et Canal-Antilles (programmes
de Canal +), auxquels s'ajoute un réseau de télévision
cablée (Martinique TV-Câble) et un bouquet de chaînes
françaises par satellite, Canal Satellite Antilles, disponible
depuis août 1998, complétent le paysage audiovisuel
de l'île.
Il existe de nombreuses radios locales, associatives ou commerciales,
sur la bande FM.
En savoir plus :
RFO
Martinique
Radio Caraïbes International
Source : Ministère de
l'Outre-mer et IEDOM
